La transition écologique à l’œuvre dans la culture
La transition écologique n’est plus une chimère ni une arlésienne qu’on agite et encore moins un vernis ornemental. C’est désormais une « urgence » qui se traduit en actes concrets et qui sert de boussole aux politiques régionales. Feuille de route Néo Terra – de la Région Nouvelle-Aquitaine, guide de la Transition écologique et bientôt feuille de route « Culture et Transition » – du ministère de la Culture sont autant de marqueurs qui font avancer l’ensemble du secteur vers des pratiques plus responsables et durables.

Singkham_©pexels.com
La Nouvelle-Aquitaine fourmille d’initiatives et de projets qui intègrent la notion de transition écologique dans leurs objectifs ou leurs paramètres de création.
La feuille de route « Culture et Transition » sur laquelle la Région travaille depuis plus d’un an avec l’appui de David Irle (co-auteur de Décarboner la culture) et Cyril Delfosse (Le Bureau des acclimatations), a d’ailleurs permis de dresser un diagnostic très encourageant en ce sens : « Le secteur culturel est déjà très engagé dans la transition écologique, et les structures ont largement conscience », note Elisabeth Douzille, directrice de la Culture et du Patrimoine à la Région.
« En revanche, les acteur·rices ont fait remonter un besoin de formation ou de partage de connaissances pour évaluer les actions à réaliser en priorité ».
Ce diagnostic a aussi permis de prendre conscience des impacts et d’identifier les éléments qui pèsent le plus lourd en termes d’empreinte carbone, à savoir : la mobilité des publics (et, à la marge, celle des opérateur·rices culturel·les), la consommation énergétique des lieux culturels (en fluides et eau), l’alimentation des publics et des artistes. Des impacts varient bien évidemment selon les spécificités des secteurs. Un important travail de cartographie des initiatives existantes et inspirantes a pu être effectué dans le cadre d’Objectif 13, projet de recherche-action interrégional qui réunit 5 agences – parmi lesquelles l’OARA (Office artistique Région Nouvelle-Aquitaine) – autour de l’enjeu de la décarbonation dans la filière du spectacle vivant. Il est notamment apparu dans ce diagnostic qui a duré deux années que les musiques actuelles sont très en avance en matière de transition écologique, avec une tradition de concertation très forte qui permet par exemple au secteur de rationnaliser les tournées et d’assurer un certain équilibre entre la production et la diffusion.
BUDGET VERT ET ÉCO-CONDITIONNALITÉS
Aussi, et de manière transversale, la Région a inscrit les transitions environnementales et sociétales au cœur de ses objectifs depuis 2019 grâce à la feuille de route Néo Terra, qui s’articule autour de six ambitions thématiques (reconstituer les ressources naturelles, ancrer les solidarités au cœur des transitions, se nourrir, innover pour une économie responsable et durable, se déplacer et habiter dans des territoires adaptés au changement climatique, prévenir et soigner) avec des engagements chiffrés et des actions concrètes dans chaque domaine. Au rang des outils à mettre en place dans le cadre de cette « boussole commune » que constitue Néo Terra, apparaissait la volonté de définir un « budget vert », outil de comptabilité et d’analyse permettant d’aller vers une cohérence entre les ambitions et les décisions : « La Nouvelle-Aquitaine a été expérimentatrice pour travailler sur ce budget vert et analyser les dépenses favorables, neutres ou défavorables à la transition énergétique. Il est ressorti que les indicateurs sont encore trop larges et nécessitent d’être affinés pour une évaluation pertinente des dépenses, car à ce jour, il n’est par exemple pas possible de différencier une rénovation classique d’une rénovation énergétique avec ces indicateurs », explique Elisabeth Douzille.
Un autre outil sur lequel la Région a en revanche bien avancé concerne les éco-conditionnalités des aides : la rédaction d’une charte d’engagements du bénéficiaire d’aide régionale envers la Région Nouvelle-Aquitaine permet ainsi d’inciter à « être acteur·rice de son territoire et de son écosystème » pour aller vers une « Nouvelle-Aquitaine décarbonnée, dynamique, solidaire et prospère ».
Les thématiques prioritaires rejoignent les ambitions de la feuille de route Néo Terra : respect des ressources naturelles ; transition pour tous·tes – concernant la formation des salarié·es notamment ; éco-responsabilité et décarbonation. Cette charte vise avant tout des obligations de moyens, et non de résultats, précise Elisabeth Douzille : « Il s’agit par exemple pour les structures de consigner les mobilités de leurs publics, leur consommation d’énergie, la provenance des produits… avec pour seule obligation de faire remonter les données, puis de mettre en place un plan d’action sur le sujet ».
Si 2024 est l’année test, 2025 sera l’année de rodage et de mise en place.
CAHIER DES SOLUTIONS
Partant du constat que la Nouvelle-Aquitaine est un territoire engagé, que la prise de conscience s’est accélérée avec les catastrophes climatiques récentes et que la mise en place d’outils et d’information s’avère nécessaire, la Région a souhaité accélérer le travail en transversalité autour de ses différentes compétences. La feuille de route préparée depuis plus d’un an de travail sera présentée au vote des élu·es de l’Assemblée régionale en mars 2024. Elle se fixe 11 défis à relever autour de trois objectifs : développer un secteur culturel robuste et résistant aux crises, soutenir la transition écologique par les activités culturelles et organiser les conditions de la transition écologique du secteur.
Il y aura un groupe de travail par défi et pour compléter cette feuille de route, un cahier des solutions sera élaboré afin de travailler plus finement sur des actions précises avec les porteur·euses et selon les projets. Une manière de faire émerger des solutions et parfois de bénéficier de sources de financement externes selon les situations (pour de la formation par exemple ou en répondant à un appel à projet).
« La transition n’est pas qu’un sujet technique, c’est aussi une philosophie, qui concerne directement le modèle économique, c’est pourquoi il faut accompagner les structures dans leur mutation (par des DLA, des appels à projet…) afin qu’elles s’ouvrent davantage à la coopération ou qu’elles inventent de nouveaux modèles de gouvernance ».
Le réemploi d’éléments de scénographie fait quant à lui partie des mesures à prendre pour « créer autrement » selon le guide de la Transition écologique dans le monde de la culture. En Nouvelle-Aquitaine, un projet ambitieux porté par l’association Ciné Passion en Périgord et labelisé « Grande Fabrique de l’image » de France 2030 va permettre de faciliter et même d’instituer cette pratique : la friche industrielle France tabac à Sarlat (24) va être réhabilitée en studios de tournages, plateaux techniques de formation aux métiers techniques du cinéma, et en ressourcerie / recyclerie / matériauthèque pour les décors de cinéma, mais aussi pour le spectacle vivant ou les artistes plasticien·nes.
La Région se voit encourager de plus en plus de dynamiques durables dans le secteur culturel, sur l’ensemble du territoire néo-aquitain : ainsi le collectif Slowfest sensibilise et incite à des pratiques moins énergivores dans le spectacle vivant ; la filière Livre et cinéma est encouragée par l’ALCA (Agence Livre, Cinéma & Audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine) pour développer l’éco-responsabilité dans ses pratiques (recensement des pratiques, analyse de l’impact écologique et préconisations).
Forte d’un terreau fertile d’initiatives dans tous les domaines de la culture, la Région met en place une vaste stratégie pour encourager la transition écologique à tous les niveaux. Et il apparaît que, dans le secteur culturel comme ailleurs, les solutions surviennent toujours dans la coopération et
le travail collaboratif.
NÉO TERRA
La feuille de route régionale pour les transitions, affiche 6 ambitions :
- Reconstituer les ressources naturelles pour l’avenir
- Ancrer les solidarités au cœur des transitions
- Se nourrir : accélérer les transitions agroécologiques et alimentaires
- Innover pour une économie responsable et durable
- Se déplacer et habiter dans des territoires adaptés au changement climatique
- Prévenir et soigner : une approche unifiée de la santé des écosystèmes
LE GUIDE D’ORIENTATION ET D’INSPIRATION POUR LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE DE LA CULTURE
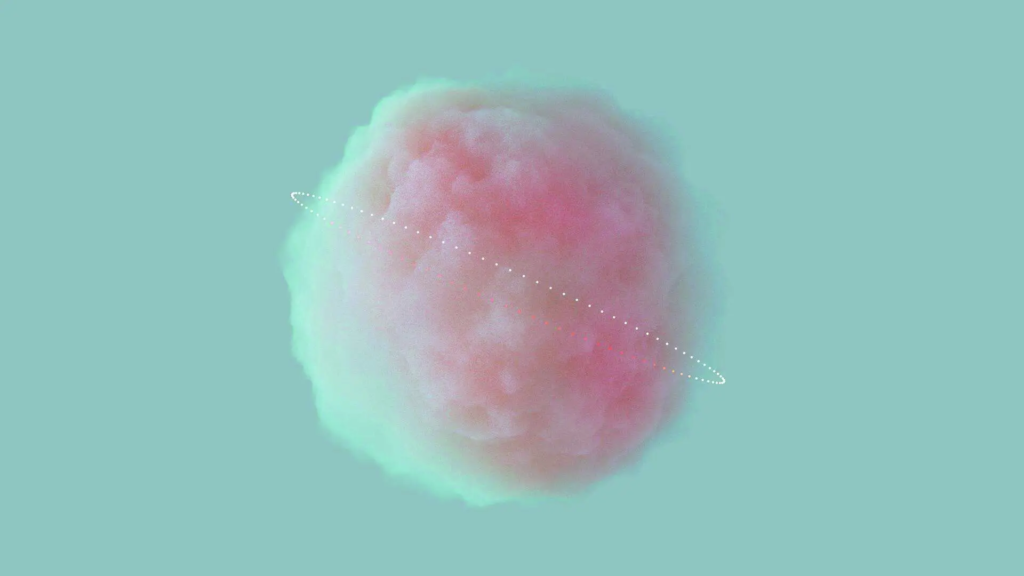
À l’automne 2023, le ministère de la Culture a rendu public ce guide qui fixe des cibles très concrètes, associées à un calendrier pour mener à bien la transition de la culture. Il porte sur les trois grands chantiers écologiques : décarboner et s’adapter au changement climatique, enrayer la crise de la biodiversité, accroître notre sobriété et la lutte contre les pollutions.
➜ culture.gouv.fr
FRANCE TABAC À SARLAT OU L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE EN ACTION

« Le projet de reconversion de France Tabac est 100 % orienté vers et animé par des objectifs de développement durable », annonce Rafaël Maestro, directeur de l’association Ciné Passion Périgord, qui porte le projet de reconversion de la friche industrielle basée à Sarlat en acteur·rice majeur de la production cinématographique.
Ce projet a été labélisé dans le cadre de l’appel à projet la Grande Fabrique de l’Image – France 2030, par le Centre National du Cinéma en novembre 2023.
L’industrie du cinéma est une pratique polluante et énergivore (transport des équipes, construction et destruction des décors et costumes, alimentation, gestion des déchets…) et le CNC a déjà lancé en 2021 le plan « Actions ! » afin d’accompagner la filière dans sa transition écologique. L’ancienne fabrique de tabac de Sarlat, qui a définitivement fermé ses portes en 2019, occupait des locaux de 26 000 m2 total. Une belle base de départ qui permettra de créer trois espaces interdépendants dans le cadre du projet :
- une école publique pour former aux métiers techniques du cinéma : la décoration, l’électricité, la machinerie mais aussi l’habillage et l’ensemble des « métiers d’art »
- un studio de tournage de 1 000 m2 qui servira d’outil de production territorial pour le Grand Sud Ouest et qui s’articulera autour de l’école de formation (les élèves pourront en effet s’exercer sur un projet réel, à l’image des restaurants d’application des écoles de restauration)
- une ressourcerie pour le cinéma, installée sur quatre niveaux de 6 000 m2 au total, qui permettra de remettre dans le circuit des décors ou de transformer ces derniers pour
du réemploi.
Côté calendrier, le projet prévoit une filière labelisée dès la rentrée 2024, l’ouverture de la recyclerie en 2026 et un site entièrement opérationnel en 2027. Le modèle économique (avec un outil dédié à la gestion du site envisagé) ainsi que l’ergonomie optimale du lieu sont toujours à l’étude, et il y a fort à parier pour que tout le monde se retrouve gagnant : les producteur·rices baissent leurs coûts de production, la formation se veut qualitative et appliquée, avec des perspectives d’emplois bien réelles, les tournages baissent considérablement leur empreinte carbone.
De plus, « le projet s’inscrit dans une très bonne temporalité, indique Rafaël Maestro, puisqu’à partir du 1er janvier 2026, les aides du CNC seront obligatoirement conditionnées à des critères de développement durable, en particulier sur la partie décors. »
Et de conclure : « C’est un projet hybride assez ambitieux, qui vise à la fois la formation de la jeunesse, le développement économique du territoire et le rayonnement encore plus grand de la région en termes de développement économique et culturel ».
Ces éditions de l’Affût peuvent vous intéresser


